

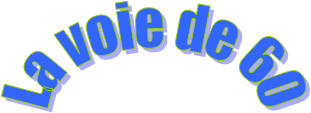




|
Après la défaite franco-espagnole de Trafalgar le 21 octobre 1805, les Britanniques instaurent le blocus des ports français le 15 mai 1806. En représailles, le 21 novembre 1806, Napoléon impose le blocus continental des ports français alliés et pays sous influence française pour empêcher les Anglais d’acheminer leurs marchandises ; le sucre de canne en provenance des Antilles devenu rare, provoque la flambée de son prix. Napoléon encourage la recherche d’un produit de remplacement. En 1812, Benjamin Delessert réussit l’extraction du sucre de la betterave qui devient concurrentiel. Malgré les diverses crises, en 1836 on comptait 360 sucreries en France. |
|
Au début du 19ème siècle (on ne connaît pas la date précise), la première sucrerie de l’ancien groupe Béghin s’ouvre à Thumeries qui en devient le fief. Vers 1821, les deux frères Coget créent une sucrerie dans une ferme où deux cents tonnes de betteraves sont traitées chaque jour. En 1839, Antoine Béghin épouse Henriette, la fille de Joseph Coget ; il succède à son beau-père après le décès de celui-ci et développe Thumeries jusqu’à sa mort en 1871. Son fils Ferdinand, né en 1840 continue également de développer Thumeries jusqu’à sa mort en 1895. En 1898, les deux fils de Ferdinand, Henri et Joseph créent la Société Ferdinand Béghin. Cette société s’agrandit avec Corbehem et d’autres sites ; elle devient en 1919 la plus grande sucrerie européenne. Au fil des années elle se développe, en rachète d’autres et ne cesse de moderniser l’outil de production, principalement entre 1910 et 1960. En 1871, Auguste Say avait fondé une sucrerie à Paris ; en 1967 elle passe sous le contrôle de Béghin et en 1973, les deux sociétés fusionnent pour devenir la société Béghin-Say. 350 000 tonnes de sucre sont écoulées en France chaque année |
|
En 1872, Jules Linard avait fondé l’usine d’Escaudœuvres. En 1899 elle est appelée la ‘plus grande sucrerie du monde’ ; elle est prise sous le contrôle de Béghin en 1972 et en location-gérance en 1986. <— Jusque dans les années 1970, Ferdinand - fils d’Henri - qui entre autres était un grand amateur de golf, se rendait régulièrement à Corbehem et avait pour habitude de venir ménager certains intérêts, saluer et discuter avec le personnel. |
|
A Ecourt, on parlait plus familièrement de ‘ch’tiot train’ ; la largeur entre les rails était de 60 centimètres. Un premier projet de construction entre Arras et Cambrai - à l’initiative des habitants de Vis-en-Artois - voit le jour en 1880 ainsi que d’autres qui suivent mais ne sont jamais concrétisés. Ce sont finalement les Anglais, précurseurs du chemin de fer qui en raison de la guerre de 1914-1918 construisent un réseau de 720 kilomètres, pour approvisionner les troupes en vivres et matériel. Après le conflit, il reste 124 kilomètres de voies. En 1919, les Britanniques les cèdent gracieusement à la France qui les met au service des régions libérées. Après réfection, le réseau repasse à 585 kilomètres et sert à relier deux carrières de grès, trente briqueteries, trois fours à chaux, une cimenterie, seize sablières et plus de quarante autres sites industriels. Les voies rejoignent Noeux-les-Mines et Béthune. Le réseau est relié aux Chemins de fer de la Compagnie du Nord à Boisleux, Marquion, Achiet et Bapaume ; il dessert deux canaux : à Palluel le quai Malderrez et à Arras le quai Méaulens. |
|
Ceci est la première page d’un texte de 10 pages figurant dans la prochaine revue n° 9
Merci à Serge Leblanc |
|
LES AUTRES PAGES |
|
|